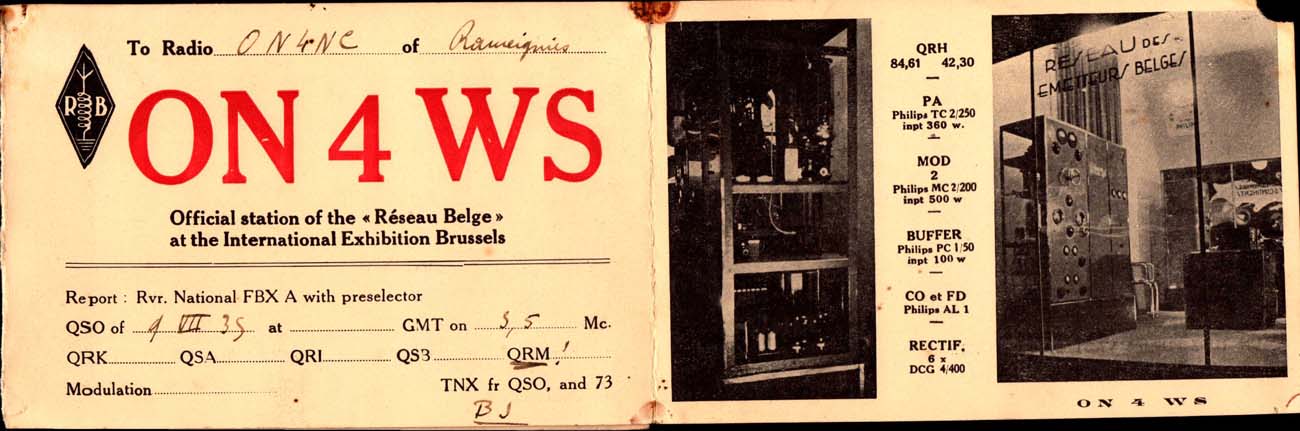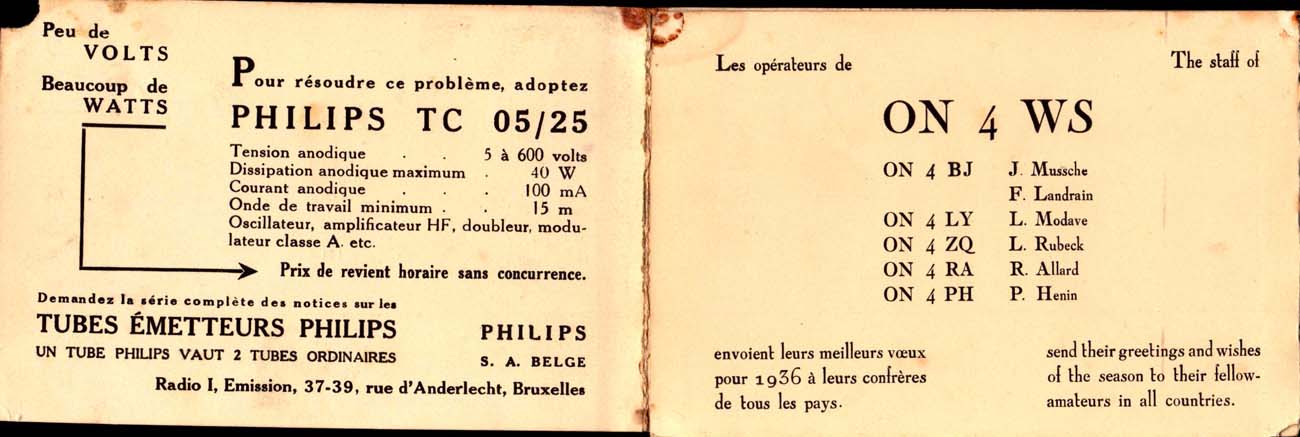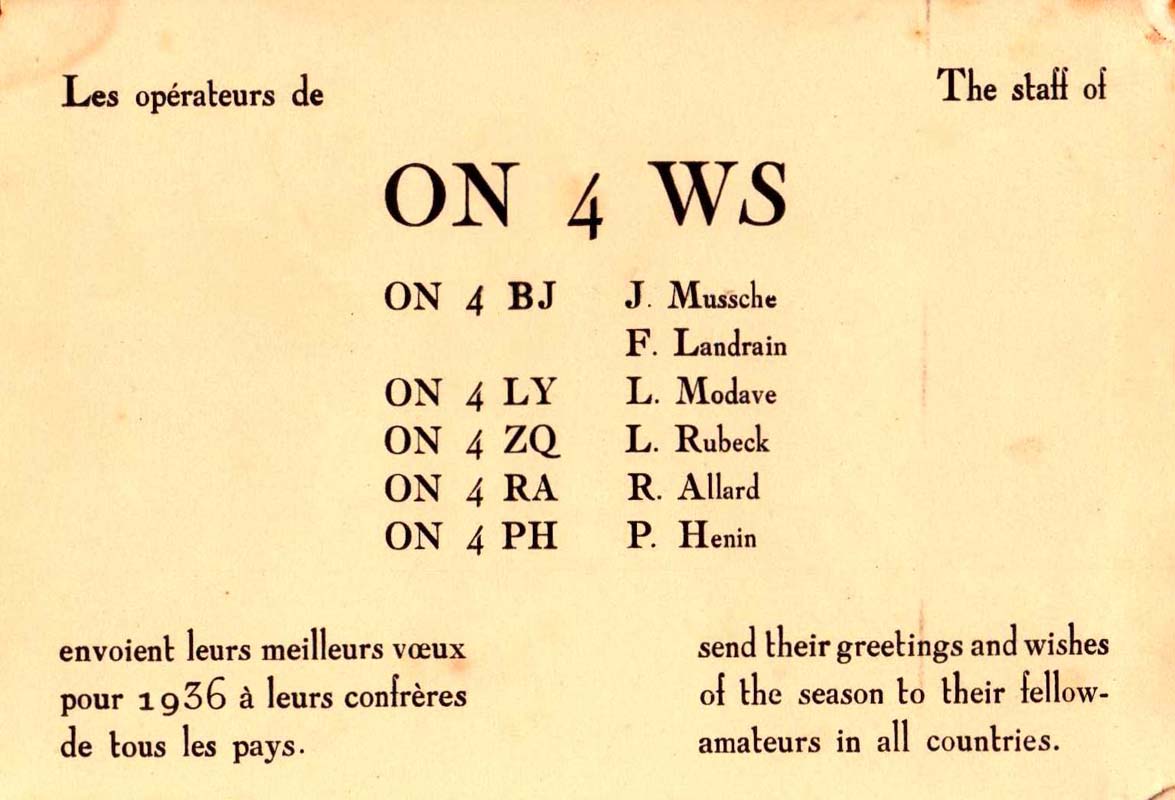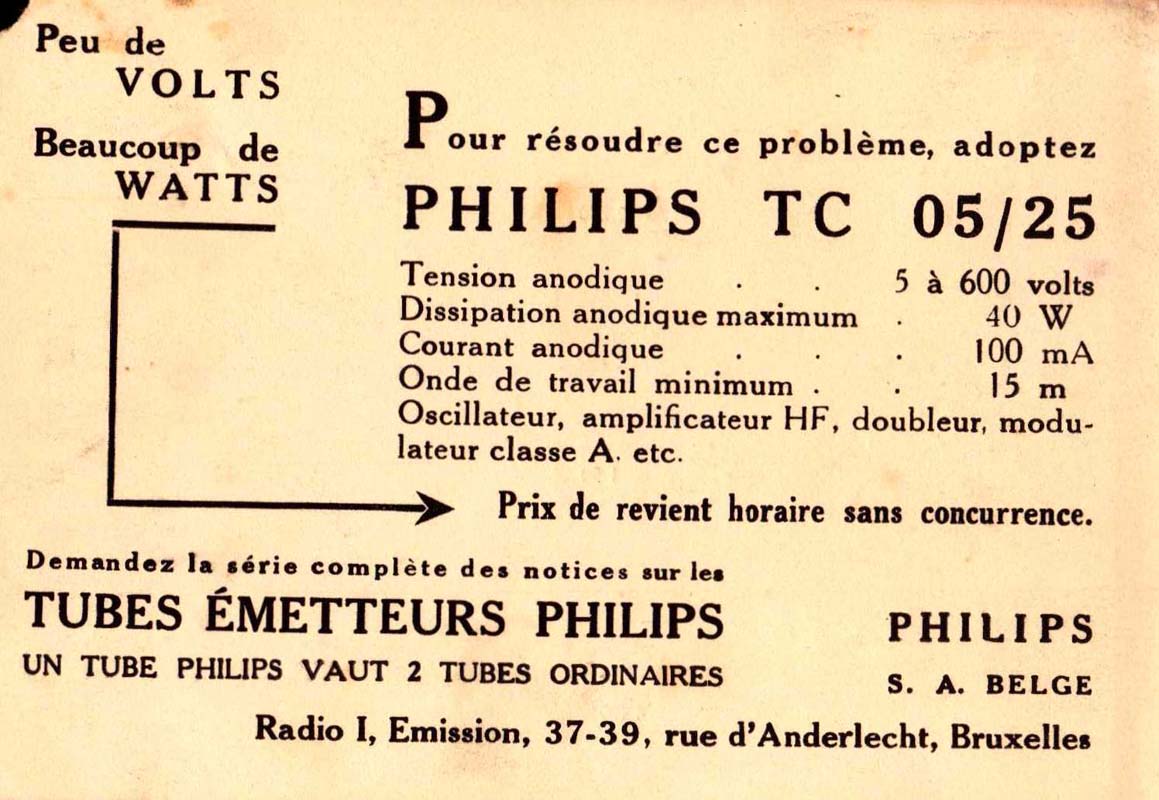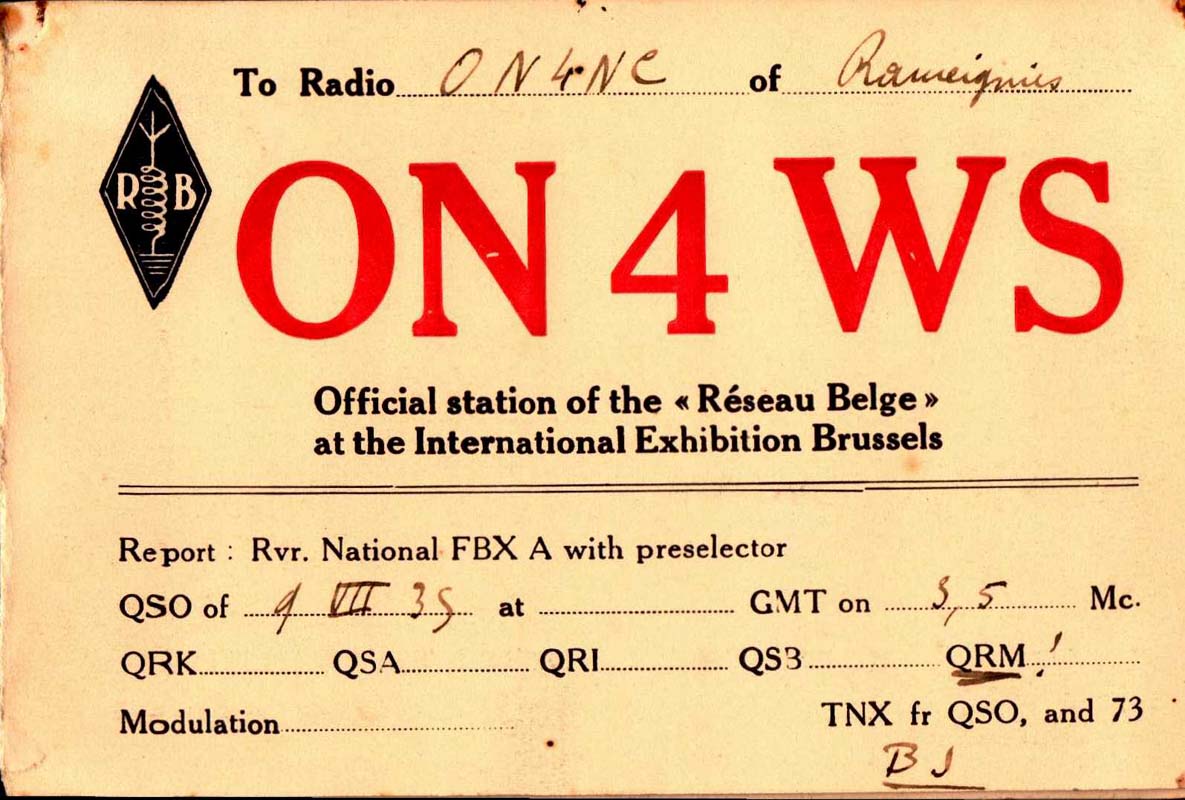27/4/1935 – 6/11/1935
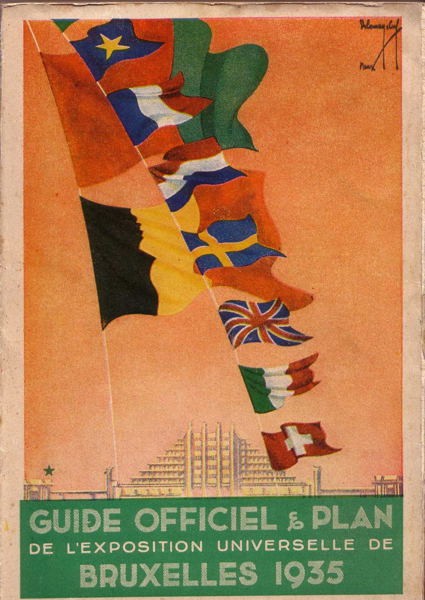
Célébration des transports
En 1935, la Belgique célébrait le centenaire de la création de sa première ligne de chemin de fer. C'est donc tout naturellement que le thème des transports fut choisi. On retrouve d'ailleurs, sur la façade du Grand Palais, différentes statues, allégories des transports belges : aviation, navigation, locomotive à vapeur... Cet anniversaire fut l'occasion pour la Belgique et les pays participants de revenir sur les progrès accomplis en matière de transport pendant un siècle. Le public pouvait également visiter le prototype d'une gare « modèle ».
Entre art et technique
L'Exposition se proposait de fournir aux visiteurs une vue d'ensemble de la production humaine. Ainsi, les savoirs techniques et l'art dans toute leur diversité furent célébrés. Pour concrétiser ces objectifs, c'est l'architecte Joseph Van Neck qui fut choisi pour concevoir les plans de l'exposition. Son expertise en matière d'expositions universelles et internationales faisait de lui la personne idéale pour s'occuper d'un tel chantier. Il réussit à faire du site un endroit harmonieux et bien pensé. Sa réalisation principale, le Palais des Expositions, était une structure monumentale faite de béton armé. L'utilisation de ce matériau montrait bien que l'innovation avait sa place au cœur de l'Exposition.
La présence de grandes maisons
En dehors des pavillons liés à l'industrie, de nombreuses entreprises étaient présentes lors de l'Exposition. Deux d'entre elles lancèrent d'ailleurs des nouveaux produits spécialement pour l'occasion, sans savoir qu'ils allaient devenir très populaires. La maison Lancôme y présenta ses premiers parfums et le chocolatier Côte d'Or conçut ses mignonnettes de chocolat en guise d'échantillons. Aujourd'hui, elles sont devenues un produit phare de la marque.
La création du site d’Heysel
L'Expo 1935 a beaucoup apporté à la ville de Bruxelles et au pays. D'un point de vue économique, elle a permis à la Belgique de se redresser après la crise des années 30. Ce fut aussi l'occasion de rénover la zone du plateau d'Heysel qui était quelque peu délaissée. En effet, d'importants travaux d'aménagement y ont été faits. À l'heure actuelle, le Palais des Expositions et les bâtiments qui l'entourent, constituent le complexe « Brussels Expo » qui est le plus grand parc des expositions du pays. C'est à cet endroit également que s'est déroulée la très célèbre Expo 1958.
Source : http://www.bie-paris.org/site/fr/1935-brussels
La station du Réseau Belge à l’Exposition Universelle de Bruxelles (1935)
ON4WS est l’indicatif attribué à la station de l’Exposition Universelle de Bruxelles de 1935. Mais, dans un premier temps, ce fut l’émetteur de ON4VC qui fut utilisé.
« Jusqu’à présent, c’est toujours le bel Xmiter de 4VC qui joue le rôle de station du R.B. à l’Expo, notre propre émetteur devant être terminé dans une huitaine de jours. » (‘QSO’ 07/1935, p.122)
La station¹, installée dans le ‘Palais de la Télévision’² (Avenue du Gros Tilleul), impressionna la horde de visiteurs. (Plus de 23000 visiteurs à ce stand pendant les deux jours de Pentecôte !)
L’Exposition connut en effet un succès retentissant et le Réseau Belge en eut sa petite part. « Si toutefois le trafic y effectué fut assez réduit, il ne faut pas en accuser les organisateurs. » (‘QSO’ 03/1936, p.46)
« La réception (…) est bonne quoique terriblement affectée par la proximité du parc des attractions. » (‘QSO’ 07/1935, p.122)
Quant à l’émission, « 4WS et les amplis de télévision ne s’entendent pas fort bien. » (‘QSO’ 07/1935, p.122)
Cette ‘induction malencontreuse’ sonna le glas de la station d’amateur. Malgré une obligation d’émettre « tous les matins tôt et presque chaque soir après clôture de la télévision » (‘QSO’ 08/1935, p.142), les stations 4VC et 4WS furent mises sous scellés, « résultat tragique de la trop grande faconde³ de nos opérateurs. » (‘QSO’ 09/1935, p.166)
Sic transit gloria mundi.
¹ Une description exhaustive de la station ON4VC est parue dans le ‘QSO’ 09/1935, pp.169-170. Photos, descriptif et carte QSL de ON4WS en annexe.
² Les premières expériences publiques de télévision eurent lieu à l’Expo de Bruxelles (1935), avant Paris, à l’aide des appareils de la Société des Compteurs de Montrouge, brevet Barthélémy. (Source : Le Livre d’Or de l’Exposition Universelle de Bruxelles, 1935.)
³ Mot au sens péjoratif : loquacité, incontinence verbale.
Liste des Palais de L’Exposition Universelle de 1935
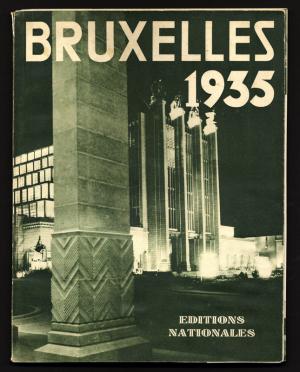
Grands Palais
Gare Modèle
Hall Latéral de Droite
Hall Latéral de Gauche
Participations Françaises
Agriculture
France d'Outremer
Maison de la Fontaine (Section française des Eaux et des Forêts)
Ministère de l'Air
Palais de la France Métropolitaine
Ville de Paris
Pavillons de la Section Belge
Agriculture
Alimentation
Art Ancien
Art Moderne
Arts Décoratifs
Arts Graphiques
Automobile
Bâtiment
Chapelle d'Arts Religieux
Chapelle Maris Stella
Collectivité des Emballages et des Etalages
Cuir
Eaux et Forêts
Electricité Ménagère
Expositions Temporaires
Ferme Modèle
Gaz
Industries Chimiques
Palais de la Ville de Bruxelles
Papier Peint
Pavillon d'Honneur du Commissaire Général
Province de Brabant
Textiles
Vie Catholique
Section Coloniale Belge
Entreprises Coloniales Privées
Pavillon Officiel du Congo Belge
Société Auxiliaire de Propagande Coloniale "Soprocol"
Divertissements
Alberteum
Plaine des Attractions
Planétarium
Royaume des Enfants
Soukhs
Théatre
Train Miniature
Vieux Bruxelles
Village Indien
Zoo
Participations Italiennes
Boutiques Italiennes (ENAPI)
Chimie
Ministère de la Presse et de la Propagande
Navigation, Aéronautique et automobile
Optique
Palais du Licteur, Pavillon Principal de l'Italie
Pavillon des Echanges et Produits Agricoles
Textile
Tour Innocenti
Vallée des Alpes
Ville de Rome
Pavillons des Participations Etrangères
Autriche
Brésil
Bulgarie
Chalet de la Fédération des Femmes Hongroises
Chili
Danemark
Egypte
Finlande
Grand-Duché du Luxembourg
Grande-Bretagne
Grèce
Hall International
Hongrie
Iran
Lettonie
Norvège
Palestine
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
Pavillons Privés
Agence Dechenne
Ateliers de Coene & Fils
Byrrh
Chaulux
Comptoir Tuilier de Pottelberg
Côte d'Or
Cristalleries Val Saint Lambert
Ecole Ménagère Agricole
Engema
Grands Magasins "Au Bon Marché"
Hacienda Martini & Rossi
Het Laatste Nieuws
Huile Impériale
Huilever
INR (Institut National de Radio-Diffusion)
L'Automobile Club
L'Illustration
Larousse
Le Soir
Liebig
Malmédy
Manufactures d'Hemixem
Max Janlet & Dominique
Olida
Paris-Soir
Persil
Philips
Presse périodique
Singer
Solvay
Texaco
Télévision
Torck
Touring Club
Usines Remy
Vanderborght
Verre
Welkenraedt
La télévision

Une inscription, au fronton de ce pavillon rapprochait de l'inauguration du premier chemin de fer en 1835, les premières expériences publiques de télévision, en 1935. Le cinéma (à l'Alberteum), la radio-diffusion (au Pavillon de l'I. N. R.), la télévision, synthèse de ces deux merveilles des temps modernes, étaient donc représentés de façon égale à l'Exposition de Bruxelles.
Les expériences eurent lieu à Bruxelles, avant Paris, à l'aide des appareils de la Société des Compteurs de Montrouge, brevet Barthélémy, appareils analogues à ceux adoptés par le ministre des P. T. T. français pour l'équipement des postes d'Etat.
A l'intérieur du Pavillon, le visiteur se trouvait devant un petit écran sur lequel apparaissait l'artiste — chanteur ou musicien — qui se trouvait dans le studio voisin : l'image était réduite et teintée de vert. L'artiste devait s'enduire la figure d'un maquillage spécial et peu flatteur; mais l'image était fidèle et parfaitement reconnaissable. Le son, d'autre part, n'était nullement modifié à la transmission; un poste à ondes courtes avait été installé, pour ce faire, à l'intérieur du Pavillon, par des techniciens de Radio-Schaerbeek.
Le principe était le suivant : la scène se passait dans une cage de verre, sous le feu de huit puissants « sunlights ». Dans une caméra, derrière un objectif semblable à celui de l'appareil de prises de vue, un disque d'aluminium perforé de trous en spirale, tournait à 1,500 tours. Il filtrait la lumière et chaque rayon frappait une cellule photo-électrique; celle-ci à son tour, envoyait des rayons au poste émetteur, qui les renvoyait sous forme d'ondes.
Un poste récepteur accueillait celles-ci et les transmettait (à raison de 60 lignes, 25 images, 90,000 « impulsions » par seconde) à un écran spécial, formé d'un ballon de verre recouvert, à sa partie supérieure d'une substance fluorescente. Le contact des électrons avec cette substance permettait de reconstituer l'image par points lumineux successifs. La vue transmise et présentée au public mesurait environ 20 centimètres carrés; une dizaine de mètres séparaient de l'écran les artistes « télévisionnés ».
Si la méthode, à ses débuts appelle des perfectionnements encore, elle n'en présente pas moins la solution d'un problème passionnément discuté. Et le succès du Palais de la Télévision fut très vif. Il n'attira pas seulement l'attention des foules. Entre autres visites officielles, il reçut celles du Roi Léopold III, des Ministres Devèze, Van Isacker, Destrée, du Bus de Warnaffe; de MM. Adolphe Max, Van de Meulebroeck, le comte Adrien van der Burch, Caspers, Charles Fonck; de M. Laroche, ambassadeur de France et des membres de nombreux groupements scientifiques et autres.
© Le Livre d'Or de l'Exposition Universelle de Bruxelles 1935
INR (Institut National de Radio-Diffusion)

L'Institut National de Radio-Diffusion avait élevé, non loin de l'Alberteum et du Planétarium, en bordure de l'avenue du Marathon, un pavillon de 30 mètres sur 20. Le bâtiment, d'allure très moderne, était l'œuvre de l'architecte Diongre, chargé après concours, d'édifier à Ixelles la Maison de l'I.N.R
Au centre d'un rectangle, se trouvait un auditorium en forme de losange tronqué, long de 17 mètres, large de 11 mètres, haut de 7 m. 50. Une galerie vitrée l'entourait, décorée de portraits photos, croquis et charges; par des baies ouvertes à la lumière, fermées aux bruits du dehors, le public pouvait assister à la naissance des émissions.

Le visiteur pénétrant par l'entrée principale, trouvait à sa droite l'enregistrement magnétique sur bande d'acier dont les méthodes lui furent révélées à certains jours; à sa gauche, l'enregistrement sur disques, devant lui, en contre bas de la Radio centrale, avec ses neuf panneaux d'amplification, trois plateaux pour pick-up, etc.
Le regard, passant par dessus la Radio centrale, pénétrait dans l'Auditorium; là, il découvrait les musiciens des orchestres, grands et petits, répétant ou exécutant. C'était, en somme, un avant-goût de la Télévision.
Neuf diffuseurs, répartis dans le couloir accessible au public et commandés par des « inverseurs » que les visiteurs pouvaient utiliser, permettaient à ceux-ci d'avoir, soit l'écoute directe du concert donné sous leurs yeux, soit l'écoute de l'émission telle qu'elle était fournie aux auditeurs par l'émetteur de Velthem. De la sorte, le cycle (de l'émission à la réception) était fermé et le résultat soumis à l'appréciation instantanée du visiteur spectateur.
L'I. N. R. assura dans son pavillon des émissions quotidiennes, radio-diffusées soit sur 484, soit 322 mètres. Ces séances concerts, jeux radiophoniques, sketches furent données avec le concours de :
1°) l'orchestre symphonique (60 musiciens);
2°) du Radio Orchestre (31 musiciens);
3°) de l'orchestre de genre (21 musiciens);
4°) de groupements musicaux divers;
5°) d'artistes lyriques et instrumentistes;
6°) d'acteurs, etc.
Cet édifice fut le centre de l'activité radiophonique nationale et internationale, à l'Exposition de Bruxelles. Ses installations techniques rayonnaient sur toute la superficie de la World's Fair, à l'occasion des cérémonies, reportages parlés, concerts donnés dans la Salle des Fêtes ou sur divers points de l'Exposition, fêtes organisées au Vieux-Bruxelles, etc.
Un grand nombre de ces manifestations furent retransmises par les stations étrangères, membres de l'Union Internationale de Radio-Diffusion de Genève (U.I.R.).
Enfin, maintes séances données dans le Pavillon de l'I. N. R. étaient régulièrement radiodiffusées vers le Congo sur onde courte, via Ruysselede.
© Le Livre d'Or de l'Exposition Universelle de Bruxelles 1935.
Documentation
Cartes QSL